À quatre ans et demi, ce fut la maternelle. On nommait alors cela : « salle d’asile », au milieu d’une foule d’autres expressions françaises, couramment utilisées à Bischwiller (et qui le sont toujours !). Et mon premier grand amour se situe là.

C’était Sœur Marie-Odile. Jeune religieuse de l’Ordre de la Divine Providence de Ribeauvillé, elle était chargée de la direction de cette salle d’asile. Âgée alors de 25 ans, elle devait rester à Bischwiller jusqu’à l’âge de 81 ans. Et jusqu’à son retour au Père, en 1975, cette religieuse alsacienne devait me garder intact ce que j’ai toujours ressenti comme un indéfinissable amour maternel. Pour faire court, je dirais simplement qu’elle s’éteignit entre ses sœurs, à la maison de repos de Ribeauvillé, à l’âge respectable de 91 ans. Ce même jour, Paul, celui qu’elle avait appelé son « préféré », se faisait poser une prothèse de hanche dans une clinique parisienne. Tout au long de son hospitalisation, devait veiller sur lui une charmante jeune religieuse de la congrégation de la Sainte Famille, nommée Sœur Marie-Odile. Coïncidence ?
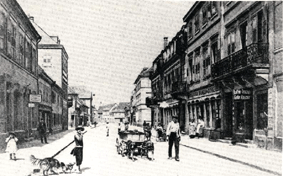 Rue principale de Bischwiller vers 1902
Rue principale de Bischwiller vers 1902
Retournons à Bischwiller. La maison de mon enfance était de très ancienne construction. Elle avait des murs àcolombages, bourrés de torchis, avec un plafond bas. Ce torchis était un véritable nid à vermines de toutes sortes, qui trouvaient là un nid idéal pour vivre et se reproduire. C’était un combat incessant, mais vain, que menait notre pauvre mère, usant de toutes sortes de moyens existant à l’époque. Ses larmes de rage impuissante, hélas, n’étaient pas rares. Et finalement, nous dûmes fuir sans conditions, devant ce qui était devenu un véritable fléau touchant des quartiers entiers de notre ville.
Nous déménageâmes alors dans un autre quartier, gagnant une maison à étage mansardé, au 32 rue des Serruriers, en face de la synagogue. Cette dernière, nichée au fond d’un petit parc, servait de lieu de culte à la communauté juive de la région, assez nombreuse à l’époque. Et à partir de ce moment, la famille Schmitt toute entière, parents et enfants, se trouva entraînée un peu malgré elle à vivre en partie au rythme du culte israëlite. Comment cela ? D’une façon tout à fait inattendue. Le vendredi soir marquant le début du sabbat, il est par conséquent interdit à tout juif pratiquant d’allumer feu ou lumière. Monsieur Læmmel, le bedeau, vint nous demander de bien vouloir suppléer à cette fonction durant la période hebdomadaire de restriction talmudique, ce qui nous valut dès lors la confiance de la communauté. Beaucoup d’entre eux étaient boutiquiers. Mon frère Louis alla apprendre le commerce des draps chez l’un d’eux, Paul Strauss. D’autres étaient marchands de bestiaux. Et parce qu’un paysan ne réussissait que péniblement à vendre seul une bête à un autre paysan, chacun faisait invariablement appel à un David, un Minkes ou encore à un Picard, tous issus de la même communauté, pour y parvenir plus aisément. D’autres, enfin, étaient houblonniers, sorte de prérogative pour une religion réputée en Alsace comme « houblonnière ». Leurs fils, lorsque leurs parents ne pouvaient pas leur offrir desétudes au collège (établissement où l’enseignement se payait fort cher), venaient s’asseoir à nos côtés sur les bancs de l’école catholique. Jamais chez les protestants.
Catholiques, nous étions très minoritaires. En effet, Bischwiller était – et est encore, à l’heure où j’écris – « Konsistorialort » (paroisse consistoriale), luthérienne, de la Confession d’Augsbourg. Outre trois pasteurs, un inspecteur ecclésiastique y avait sa demeure : le pasteur Konrad, un allemand d’origine. C’est lui qui dut achever, bon gré mal gré, son homélie d’accueil des troupes françaises en 1918 d’un grinçant « Vive la France ! Amen », à la joie quelque peu sardonique de ses ouailles bischwilléroises…
Pour les jeunes gens catholiques, il faut croire que les partis de même religion étaient rares. Aussi notre père avait choisi Maman, une luthérienne. Avec ma sœur et mes frères, nous sommes donc issus d’un mariage mixte. Je n’ai hélas pas connu personnellement ma grand mère, Madeleine Sahm, décédée en 1905. Sage-femme de son état, elle avait été mariée elle-même deux fois et avait donné le jour à une nombreuse progéniture. Farouchement protestante, il paraît qu’elle n’a jamais apprécié la décision de mon père de faire baptiser ses enfants à l’eau du baptistère catholique, au point de le lui faire savoir en levant sur lui sa canne (le légendaire « Knüppestock »), lors du baptême de ma sœur Louise, la première des neuf enfants.
Ma grand mère devait être une femme merveilleuse. Ce dont je me souviens réellement à son propos, ce sont ces instruments bizarres qui lui avaient appartenus et qui dormaient au fond d’un certain tiroir au sein d’un certain meuble de famille : canules, pincettes et autres instruments utilisés en gynécologie. Autant de sujets d’interrogations, pour les enfants fouineurs que nous étions… C’était un leg de grand mère Madeleine, enterrée au cimetière protestant de sa ville natale, où, à l’heure où j’écris, les deux communautés religieuses restent toujours farouchement séparées. J’ai installé moi-même une nouvelle planche sur sa tombe en 1932, en remplacement de la première, usée par les ans. Une planche, pas une croix, qui, elle, est la marque de reconnaissance des tombes catholiques.
Mais c’est à ma sœur Louise qu’il appartint d’illuminer les derniers jours de notre grand mère. Celle-ci avait été admise à la maison de repos des Diaconesses, en raison de ses éminents services rendus, notamment durant la guerre de 1870, comme infirmière au lazareth de Bischwiller. Cette maison était voisine de l’école où Louise était en classe (chez Sœur Marie-Catherine, la « très sévère », celle à qui je dois d’avoir fait mes premiers pas dans la langue française à partir de 1912). Chaque jour, donc, Louise quittait la classe après la cloche de 16 heures et se rendait directement au chevet de Grand’mère Madeleine Sahm, pour une heure de lecture de la Sainte Bible. Une bien belle façon de préparer la pieuse mourante à rejoindre le Père, en 1905.