L’automne de l’an de grâce 1902 m’a vu naître, à Bischwiller, au 52 de la rue des Écoles (Schulstrasse), le quartier de deux établissements scolaires (Volksschulen).
Sur les neuf naissances du couple Aloyse Schmitt et Louise Sahm, j’étais le septième..
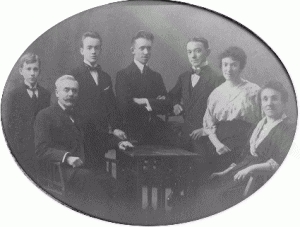
Ces neuf enfants étaient nés dans cet ordre : Louise, née en 1895, Aloyse en 1896, Eugène en 1998, Louis en 1899, Madeleine en 1900, Joseph en 1901, Paul-Pierre (moi) en 1902, Aloyse en 1903 et Émile en 1905.
Mon père, Aloyse Schmitt, alsacien de pure souche, s’était fixé à Bischwiller en 1893. Il y avait rencontré ma mère, née, elle, à Hanhofen, l’un des villages attenant. J’ai situé ailleurs* mon père, ouvrier métallurgiste, l’un de ceux que l’on désignait à la fin du siècle précédent comme « Eisendreher », tourneur sur fer.
Je peux affirmer sans risque de me tromper que cette époque se caractérisait comme celle d’une pauvreté quasi-universelle règnant dans l’Europe toute entière.
Notre bonne Alsace appartenant depuis une grande vingtaine d’année à l’Allemagne impériale, elle en partageait également son lot de misère. Par le traité de Francfort, signé en 1871, notre père, qui était né français sous Napoléon III, avait changé une première fois de nationalité, pour devenir sujet du Kaiser. Nulle Pythie ne lui avait prédit un tel destin sur son berceau, pas plus que les trois autres changements de drapeau qu’il allait connaître durant sa longue vie.
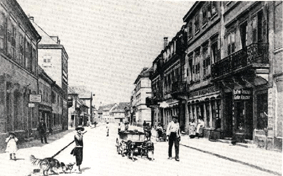

Cetteépoque chevauchait deux siècles : celui qui venait de finir et celui qui commençait à peine. Durant quelques décennies encore, feraient défaut ces inventions qui allaient révolutionner la vie de tous les jours : pas d’eau courante dans les éviers, pas même d’évier dans la plupart des modestes habitations de notre bourg d’Alsace du Nord. Pas de gaz, encore moins d’électricité. Le moteur à explosion y faisait timidement ses premiers pas. L’automobile ? Nous assistions, médusés, aux premiers tours de roues d’un engin pétaradant à souhait, puant, fusant flammes et fumées nauséabondes. Il faut imaginer un quidam, emmitouflé dans une peau d’ours, derrière d’immenses lunettes de protection, tenant entre ses mains une barre à deux poignées verticales destinée à diriger l’essieu avant aux bandages de caoutchouc plein. Nous courions derrière cette chose bruyante, étonnés de la rattraper sans peine. Et comme elle étaient drôles, les premières motocyclettes ! Les constructeurs de l’époque avaient prévu un réservoir à essence très mince, mais très long. Leur aspect n’en était que plus allongé par rapport aux engins que nous connaissons aujourd’hui. Elles n’avaient pas de démarreur. Le conducteur devait « sauter en marche », après une longue course pour parvenir à faire tourner suffisamment le moteur de cette diabolique invention. Parfois plusieurs centaines de mètres d’effort !
Nous logions mal en ces temps là , à l’étage de maisons basses, alignées en longues rangées. Nous mangions tout juste à notre faim. à table, ni vin ni autres boissons que de l’eau, une méchante eau tirée du puits, ou plus exactement de la pompe-fontaine, dont il existait un exemplaire par quartier. On allait s’y servir, en faisant la queue, le seau à la main. Bien entendu, c’étaient les « grands » qui se servaient en premier. Père s’autorisait parfois de la bière. Pour maman aussi, lorsqu’elle avait achevé une lessive particulièrement difficile (je reviendrai plus tard sur ces lessives). Je me souviens qu’un tel jour, je fus dépéché « in de Lamm » avec 12 pfennig, autrement dit : « trois sous ». « Pool, hol m’r fir drey sûû bier » (« Paul, cherche moi pour trois sous de bière »). Et Pool de recevoir, pour ce faire, une grande cruche de ménage, pouvant contenir deux litres de la boisson convoitée. Je me souviens comme si c’était hier de cette cruche, taînant habituellement sur le buffet, verte avec des fleurs rouges. Le chemin à parcourir, long tout au plus de deux à trois cents mètres, était en réfection. Tous les vingt mètres environ, un tas de sable attendait sagement d’être utilisé pour tapisser le fond de la couche de roulement. Un rouleau compresseur crachait sa vapeur à distance, tout en aplanissant la partie du chemin déjà garnie. Quoi de plus tentant alors, pour le jeune garnement de six ans que j’étais, que de flâner en route, observant l’engin tout en arrosant, l’un après l’autre, chaque tas de sable d’un peu de bière de la cruche, pour y faire un pâté… Hélas, quelques coups de martinet bien appliqués sur le bas du dos me firent rapidement revenir à la réalité ! Et la soif maternelle de signifier énergiquement sa juste réprobation à la coupable étourderie du jeune commissionnaire.
Les desserts n’existaient pas, à part les fruits frais de saison – comme je détestais les groseilles à maquereau ! Seules faisaient exception à cette règle les fêtes carillonnées, et les fêtes de famille. Il nous a fallu attendre 1918 et l’arrivée du grand ravitaillement venu d’outre-Atlantique, pour connaître enfin ces délices culinaires réservés jusqu’ici aux seuls nantis ! Nantis, c’est à dire minoritaires. Ne chantions nous pas, en 1916 : « Und Eier, Schinken, Wurst und Speck / Das fressen uns die Reichen weg ! » (« Et oeuf, jambon, saucisse et lard, voilà ce que nous volent les riches ») !
Mais nous n’en sommes pas encore là. 1905, donc. Une année de grand chambardement. Primo : l’eau courante. Travaux de terrassement, creusement de tranchées pour enfouir les conduites. Quel merveilleux terrain de jeu ! Pendant des mois, nous autres, jeunes enfants, nous y donnons à coeur joie.
Puis, à peine quelque mois plus tard, c’est reparti, avec l’enfouissement cette fois des conduites de gaz. Une fois achevé ce noble travail, apparition de l’allumeur de réverbères. Soir et matin, flanqué d’un flambeau à l’alcool à brûler comme d’un fusil sur l’épaule, le voilà qui parcourt les ruelles du bourg pour allumer et éteindre les « lanternes ». Nous en restions tout éblouis, alors que, pourtant, les résultats étaient bien médiocres ! Oui mais, jusqu’ici, nous en étions réduits à utiliser une « suspension » à pétrole, que l’on réglait en tirant sur la mèche. L’épicier nous procurant le précieux « lampant » pour quelque sous.
Que dire alors de l’année 1912, qui vit arriver la « fée électricité » ! Nous eûmes droit aux premières ampoules, qui éclairaient à l’aide d’un méchant filament de charbon, à la valeur d' »1 bougie ». Pas vraiment brillant-brillant…. Et là encore, je me souviens : ce fut la couturière de notre rue la première à disposer de la nouvelle installation, éclairant ainsi l’entrée de son atelier. Et notamment le couloir, ouvert aux passants. Il fallait voir cela : un simple bouton, qu’il suffisait de tourner pour avoir de la lumière au plafond. Vous pensez bien que j’y retournais souvent pour essayer. Mais ce diable de bouton faisait un vrai bruit de gachette, finissant par alerter la maîtresse de maison qui sortait en courant de son atelier, pour me tirer les oreilles !
* Texte à venir ultérieurement